
La seizième conférence internationale sur l’image accueillie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne en lien avec le projet DEM’ARTS
Les 11 et 12 septembre derniers, l’ensemble de la galerie Dumas ainsi que l’amphithéâtre Lefèbvre du centre Sorbonne ont été mobilisés pour accueillir la seizième conférence internationale sur l’image portée par le réseau de recherche The Image Research Network et co-organisée par le projet DEM’ARTS (Création, démocratie et numérique), de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
The Image Research Network est l’un des réseaux de recherche du Common Ground Research Network qui interroge la nature et les fonctions des images et de leur création. La volonté de ces réseaux de recherche est de mener des réflexions transdisciplinaires en faisant dialoguer les disciplines, avec des chercheurs et universitaires internationaux, de spécialités et de terrains différents. L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne fait partie des partenaires de The Image Research Network.
La seizième conférence internationale sur l’image a accueilli plus de 330 personnes venant de 40 pays différents. En complément des thématiques permanentes, le thème principal était « De l’esthétique démocratique à la culture numérique ». Plusieurs membres du projet DEM’ARTS ont participé à l’organisation de cette conférence : Barbara Formis, à l’origine de cette collaboration était responsable locale de la conférence, Miguel Almiron, Camille Salinesi et Azadeh Nilchiani ont formé le comité local de la conférence et l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne était hôte de l’événement. Cette conférence explore plus particulièrement la photographie et l'image photographique, ainsi que la relation entre ces formes et le langage. La photographie est née de la rencontre entre deux formes descriptives, l'écriture et la lumière, et c'est à travers le langage que sont décrits son processus et la valeur accordée à sa création. À l'heure où de nouvelles formes d'images apparaissent grâce à l'IA générative et à la photographie numérique, la conférence pose la question suivante : faut-il réexaminer la relation entre la lumière, la photographie et le langage ?
Entretien croisé avec Barbara Formis, Miguel Almiron et Azadeh Nilchiani
Vous faites partie du comité local de la conférence et vous êtes intervenus dans plusieurs sessions. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les thématiques reliées au focus de la conférence ?
Azadeh Nilchiani (chercheuse postdoctorale pour le projet et membre associée de l’institut ACTE) : Le fil conducteur de cette édition, en complément des thématiques permanentes de la conférence, était d’aborder les rapports entre l’esthétique démocratique et la culture numérique à travers l’image. Les cinq thématiques permanentes de la Conférence internationale sur l'image concernent : la forme de l'image, le travail de l'image, l’image dans la société, les technologies créatives et culturelles et les pratiques ordinaires et les comportements collectifs. Les trois conférences et la table ronde plénière avec les communications lors des sessions parallèles, durant ces deux journées, ont été les lieux de débats et de questionnements sur ces thématiques, non seulement du point de vue de création, mais également sur la dimension sociale et politique qu’ils impliquent. Il a été question de comment les nouvelles technologies de notre temps, notamment l’intelligence artificielle, ont modifié à la fois la production d’images, mais aussi le langage que nous utilisons pour les produire, les décrire, les transmettre et les partager.
L'année dernière, des membres de l’équipe DEM’ARTS étaient présents à la quinzième conférence internationale sur l'image à Buenos Aires en Argentine. Pouvez-vous nous en dire plus sur les liens entre The Image Research Network, Common Ground et le projet DEM'ARTS ?
Barbara Formis (membre du projet et professeure à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : Common Ground, par ses réseaux et ses conférences, [offre] un espace de dialogue essentiel, notamment par son orientation vers les intersections entre arts et société. […] Ma collaboration avec Common Ground et mon engagement dans le projet DEM’ARTS sont intimement liés par une tension constante entre théorie et pratique, entre une vision interdisciplinaire et une mise en œuvre concrète. […] En début d’année 2023, c’est le réseau Common Ground qui s’est tourné vers moi, concrètement pour envisager l’accueil de la conférence dans nos murs à l’horizon 2025. D’emblée, j’ai pressenti que cette collaboration pourrait constituer une occasion rare de faire rayonner non seulement l’événement lui-même, mais aussi notre projet Sorb’Rising, centré sur la création, la démocratie et les arts numériques.
Les différentes interventions étaient dispensées en anglais et en espagnol. Avez-vous un retour sur la partie hispanophone de la conférence ?
Miguel Almiron (membre du projet et professeure à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : J’étais en Argentine [l’année dernière] et j'ai également eu la chance de participer à l’organisation de l'événement à Paris. Dans les deux conférences, la langue anglaise et la langue espagnole étaient présentes avec la même intensité et qualité scientifique.


Pourquoi le choix s'est porté sur l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour accueillir l'événement ? Comment s'est déroulée la collaboration ?
Barbara Formis : Le choix de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour accueillir cette importante conférence n’a pas été laissé au hasard. En réalité, cette décision s’inscrit dans une logique stratégique profondément ancrée dans la politique de l’établissement, qui se veut à la fois novatrice, ouverte et résolument tournée vers l’international.
La collaboration s’est déroulée de façon fluide. Accueillir plus de 300 participants venant du monde entier, dans un site aussi prestigieux, exige en effet une coordination sans faille. Je tiens ici à saluer et à remercier profondément Azadeh Nilchiani ainsi que nos collègues de la logistique et du service planning, dont l’aide précieuse a été un moteur pour la réussite de cet événement.
L’expérience a été intense, stimulante, et riche de toutes ces interactions : la capacité de notre université à accueillir un tel rassemblement international témoigne de sa vitalité et de son engagement pour la recherche et la création à l’échelle globale. Ce partenariat manifeste surtout une conviction profonde : que l’interdisciplinarité, associée à une capacité de mobiliser des ressources humaines et institutionnelles de haut niveau, permet d’enrichir substantiellement la réflexion collective sur ces enjeux cruciaux que sont l’image, la digitalisation, l’art et la démocratie. Dans un monde qui traverse une grande crise politique, l’art et la philosophie sont comme des lanternes qui peuvent nous guider.
Dans quelle mesure l'implication des membres du projet DEM'ARTS était pertinente pour discuter des thématiques de la conférence ?
Azadeh Nilchiani : Le focus de cette année 2025 de la conférence sur l'image a été pensé et proposé en lien avec les lignes directrices du projet DEM’ARTS, dans le cadre de cette collaboration initiée par Barbara Formis. Lors de l'édition 2024 de la conférence, qui s'est tenue en octobre à l'Université interaméricaine de Buenos Aires, en Argentine, Miguel Almiron a annoncé officiellement cette collaboration et la tenue de la conférence de cette année à Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Plusieurs questionnements touchant aux axes de travail du projet DEM'ARTS ont été présents, parmi lesquels : les réflexions sur la démocratisation des outils, les transformations induites par le numérique, de quelles manières pouvons-nous envisager une conception démocratique et partagée des arts avec le numérique, ou encore les débats autour de l’ouverture et l’accessibilité des expériences esthétiques à travers les formes d’expression artistique numériques.


Les doctorants au cœur de la conférence
Dix doctorants de l’École doctorale APESA ont modéré ou animé des sessions de la seizième conférence internationale sur l’image : Cyana Djoher Anaïs Hadjali, Johanna Jouhans, Anna Charrière, Elena Posokhova, Miel Assas, Yi Zhang, Ying Wu, Manxi Du, Grégory Mesnil et Antonia Ratto.
Des doctorants de l’École doctorale Arts Plastiques, Esthétique et Sciences de l’Art (APESA) que vous dirigez ont participé à des interventions. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur leur implication ?
Miguel Almiron : Dans les deux manifestations, des doctorants de diverses universités ont échangé leurs travaux scientifiques et ouvert des nouvelles voies. Pour nos doctorants de l’École doctorale APESA, cette expérience a été l'occasion de communiquer, de partager et de s’ouvrir à d'autres voix et d'autres voies. Une expérience qui leur permettra de se confronter au monde pluriel de la recherche dans leur avenir de chercheurs.
À propos du projet DEM’ARTS
Le projet DEM’ARTS inaugure son deuxième cycle 2025-2026 avec un focus spécial sur l’intelligence artificielle, la création et la démocratie. La séance inaugurale de ce second cycle, intitulée « IA et transformations sensibles de la démocratie », a eu lieu le 14 octobre. Animée par les membres de l’équipe scientifique du projet, cela a été l’occasion de mener des réflexions sur les mutations esthétiques, sociales et pédagogiques engendrées par l’intelligence artificielle. Il a été question des transformations des pratiques artistiques, des formes d’expressions et des modes de partage de connaissances qu’impliquent les technologies émergentes. Cette séance a permis d’aborder les enjeux esthétiques et démocratiques liés à l’IA notamment en ce qui concerne les processus de création et d’interprétation, les imaginaires collectifs et les espaces d’échanges. Le séminaire s’est également intéressé à la dimension pédagogique de ces évolutions ainsi qu’aux questions d’accessibilité, d’inclusivité et de partage des savoirs qu’elles soulèvent.
En savoir plus sur les prochaines séances du séminaire et sur le projet.
Le projet DEM’ARTS est lauréat de l'appel à projet institutionnel Sob’Rising en 2023.
Contenus liés
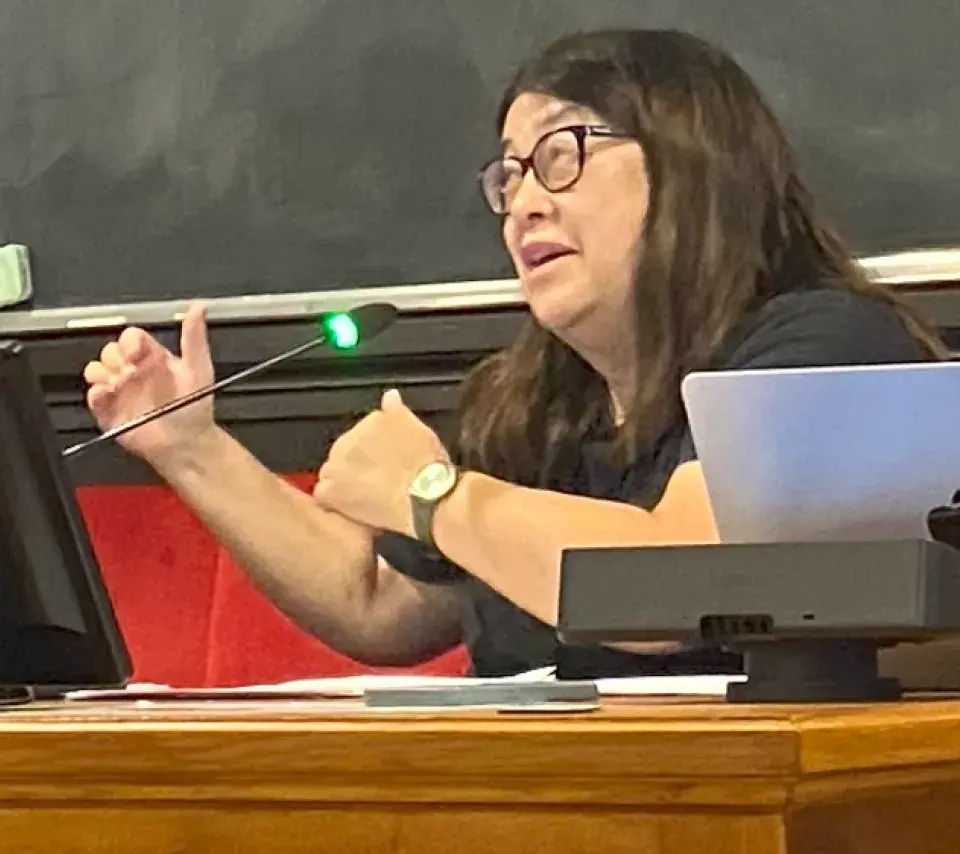
Création, démocratie, numérique : lancement du projet DEM'ARTS
La séance inaugurale du séminaire DEM’ARTS s’est déroulée le 8 octobre dernier au centre Panthéon...